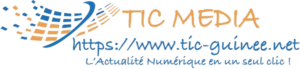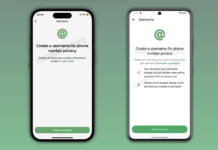En moins de trois décennies, la Chine s’est imposée comme un acteur incontournable du numérique en Afrique. Porté par des géants technologiques tels que les opérateurs Huawei et ZTE, le continent a bénéficié d’une connectivité renforcée, de réseaux 4G et 5G de plus en plus performants, ainsi que de centaines de milliers de kilomètres de fibre optique déployés. Une transformation rapide, qui a indéniablement accéléré l’inclusion numérique et modernisé les infrastructures de communication.
Cependant, derrière cette modernisation spectaculaire se dessine une interrogation centrale : l’Afrique progresse-t-elle vers une véritable souveraineté numérique, ou glisse-t-elle vers une nouvelle forme de dépendance stratégique ?
Pour comprendre les enjeux, il convient d’examiner les principaux leviers de l’influence technologique chinoise sur le continent.
Le premier, et sans doute le plus déterminant, concerne les infrastructures numériques, véritables fondations de l’essor digital africain. Au-delà des plus de 200 000 kilomètres de fibre optique installés, les réseaux mobiles de nouvelle génération 4G et 5G , permettant une amélioration considérable de l’accès à Internet et des capacités réseaux sont largement dominés par les solutions et technologies Huawei et ZTE. Un modèle souvent financé par des prêts concessionnels accordés par l’Exim Bank of China.
Mais cette dynamique a un revers : la forte dépendance aux technologies et services chinois, qui rend de nombreux États vulnérables en matière de maintenance, de mises à jour technologiques et, in fine, de souveraineté numérique.
Ainsi, si l’Afrique gagne indéniablement en capacité technologique, elle reste confrontée au risque d’une dépendance durable à un seul partenaire stratégique.
Deuxièmement, les services numériques et la gestion des données renforcent encore cette influence. Les solutions de vidéosurveillance de Huawei, Hikvision ou Dahua, ainsi que les plateformes de cloud gouvernemental et de paiement électronique proposées notament par Alibaba et Tencent, modernisent les services publics et accroissent l’efficacité administrative. Néanmoins, cette modernisation s’accompagne d’un enjeu crucial : le stockage et le traitement d’une partie des données africaines dans des infrastructures étrangères, réduisant ainsi le contrôle direct des États sur leurs ressources numériques les plus sensibles.
Enfin, le troisième pilier réside dans la formation et la diffusion de standards technologiques. Plus de 150 000 techniciens africains ont été formés par la Chine, et de nombreuses universités du continent collaborent désormais avec des institutions chinoises dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou les télécommunications. Cette coopération permet un transfert de compétences considérable mais entraîne, dans le même temps, une adoption progressive de normes et de cadres technologiques alignés sur ceux de la Chine, ancrant durablement l’influence chinoise au cœur de l’écosystème numérique africain.
Les études de cas illustrent clairement l’équilibre fragile entre modernisation réussie et dépendance stratégique.
Au Kenya, la vidéosurveillance déployée à Nairobi par Huawei démontre la capacité des technologies chinoises à renforcer la sécurité urbaine et à soutenir les autorités locales dans la lutte contre la criminalité.
Au Sénégal, le programme « Smart Sénégal », fondé sur une infrastructure de fibre optique et des services cloud gérés par Huawei, a permis d’accélérer la transformation numérique de l’administration publique.Consciente des risques liés à une dépendance technologique trop marquée, le pays s’oriente désormais vers une diversification de ses partenariats, notamment avec l’Estonie, référence mondiale en matière d’e-gouvernement.
Au Bénin, enfin, les infrastructures fournies par ZTE constituent l’ossature du réseau numérique national. Elles sont aujourd’hui complétées par des collaborations européennes axées sur la cybersécurité, illustrant une approche hybride visant à tirer parti des apports chinois tout en renforçant la souveraineté numérique du pays.
De plus en plus de pays africains cherchent à rééquilibrer leur stratégie numérique. Le Rwanda, le Gabon ou encore le Ghana refusent désormais l’exclusivité technologique de Huawei et misent sur de nouveaux leviers de souveraineté numérique.
Ils encouragent l’émergence de start-ups locales, soutiennent le développement de solutions cloud et de cybersécurité africaines, et multiplient les alliances technologiques diversifiées afin d’éviter une dépendance excessive à un seul partenaire.
L’Afrique bénéficie incontestablement des investissements chinois : infrastructures modernisées, coûts compétitifs et amélioration significative de la connectivité.
Derrière la modernisation numérique spectaculaire se cache un risque majeur : la dépendance structurelle.
Les prêts à faible taux accordés par la Chine sont souvent conditionnés à l’utilisation exclusive d’équipements chinois.
Résultat : un écosystème fermé, où la modernisation rime avec dépendance. Les pays africains disposent de réseaux performants, mais la diversification des partenaires reste limitée.
À terme, cette situation pourrait fragiliser la souveraineté numérique du continent. Modernisation et connectivité accrues ne doivent pas masquer les enjeux stratégiques de contrôle et d’autonomie technologique.
Pour éviter une modernisation importée et vulnérable, les États africains doivent renforcer leurs cadres de régulation, investir massivement dans les compétences locales et poursuivre la diversification de leurs partenariats technologiques. C’est à cette condition que le continent pourra bâtir un modèle numérique résilient, autonome et véritablement souverain.
Source : analyse inspirée par afrikipresse